J’ai aujourd’hui le plaisir de vous présenter l’autrice Charlette qui a sorti récemment, en autoédition, le second tome de son univers si particulier. Les histoires qui se succèdent dans ces livres prennent place dans notre réalité, ou plutôt une réalité alternative où certains objets seraient doués de paroles et de pensées. Certains objets, mais pas tous : seulement les œuvres d’art !
Les enquêtes de l’homme à l’oiseau nous font découvrir la vie d’une galerie d’art, au travers du regard des œuvres d’art qui y sont présentées pour être vendue. Nous voilà propulsés dans un monde étrange où, à l’image de Toys Story, ce sont les œuvres d’art qui ont don de parole, la capacité de penser… Statues, pastels ou peintures à l’huile ont donc une personnalité, des avis et nous font surtout découvrir les secrets du fonctionnement d’une galerie d’art. Les œuvres sont vraiment au cœur de l’histoire : elles ont leur propre monnaie, c’est même elles qui tentent de se modifier par elles-mêmes dans le but d’être vendues, et ce ne sont que des exemples. Il y a même une mise en abîme assez poétiques où les œuvres, non contentes d’être leurs propres restauratrices, deviennent également collectionneuses au sein de la galerie.
Quatrième de couverture :
À travers six nouvelles, le deuxième tome des Enquêtes de l’Homme à l’oiseau offre une plongée dans les coulisses d’une galerie d’art. Qui n’a pas rêvé de se glisser derrière les portes de ces espaces d’exposition ? C’est encore mieux si la visite se fait sous la houlette d’une sculpture d’argile. Clinique esthétique pour oeuvres d’art moches, projet d’assemblage façon Frankenstein d’un Savant fou ou encore traque d’un pyromane sous la forme d’un road-trip : le bureau de L’Homme à l’oiseau, sculpture de terre et gardien d’une galerie lilloise croule sous les dossiers. Chaque nuit, il guette les bips de l’alarme, le bruit mat de la porte et le cliquetis des clés avant de s’y attaquer. Est-ce que notre protagoniste de glaise et ses acolytes de bronze ou sur toile parviendront à maintenir l’équilibre des lieux : des ventes florissantes et le secret de leurs activités nocturnes ?
Un univers que nous allons découvrir ensemble grâce à Charlette qui a accepté cette invitation à s’exprimer.
Bonjour Charlette, merci de m’accorder cette interview.
L’Homme à l’oiseau est le personnage principal de cet univers, c’est également lien entre toutes les nouvelles. Il est lui-même une œuvre mais aussi le gardien de la galerie veillant à son bon fonctionnement : comment est-il né ?
Au départ, il s’agit d’une véritable sculpture, une œuvre de Fanny Ferré, une artiste dont j’admire beaucoup le travail.
À l’époque, je travaillais dans une galerie et je me suis souvent surprise à le prendre pour un être humain. Disons qu’il m’a fait sursauter plusieurs fois quand j’étais perdue dans mes pensées et que je déambulais dans le lieu d’exposition…
À partir de là, sa transition vers un personnage est assez naturelle. Je me suis posé la question : « Et s’il pouvait se lever et vivre sa vie. Qu’est-ce qu’il ferait ? » Tout est parti de ce « Et si ». J’ai écrit un premier texte pour y répondre. Je l’ai publié sur la plateforme de Shortedition. Il a bien été accueilli. Je me suis prise au jeu et j’ai fait vivre d’autres aventures à L’Homme à l’oiseau.
Les nouvelles s’articulent autour d’enquêtes, menées ou commanditées par L’Homme à l’oiseau, détective morose accroc au white spirit : vous êtes-vous inspirée d’un Sherlock Holmes à la vaine recherche de son Watson ?
C’est effectivement un hommage à Conan Doyle, façon œuvre d’art. C’est un personnage dont j’aime beaucoup l’imaginaire. Quand j’ai voulu créer un détective en terre, j’ai immédiatement pensé à Baker Street et au folklore qui s’y rattache.
À noter : je m’inspire aussi d’Agathe Christie. Des écrivain•es dont j’admire les livres. Sans compter mon amour pour la culture anglaise. Je case une bonne tasse de thé dès que je peux.
Pourtant, il est loin d’être exemplaire, d’ailleurs, toutes les autres œuvres d’art ressemblent à autant de membres d’un réseau mafieux, les nouvelles ont pour thématique générale la manipulation ; pour blaguer, pour voler des informations, pour marchander… Pourquoi cette volonté de montrer la part uniquement sombre des œuvres ?
Je pense que cela part de ma volonté de créer des intrigues, des aventures. Des œuvres qui ne font rien de leurs soirées, ce n’est pas très intéressant. En tout cas, ce n’est pas ainsi que je concevais ces textes. Je voulais créer des personnages à part entière, les mettre au cœur des intrigues. Il fallait donc des enjeux en rapport avec leur quotidien. J’ai imaginé qu’un de leurs objectifs principaux était d’être vendu. C’était leur obsession, leur quête à toutes. J’ai donc brodé mes histoires à partir de là.
Une fois prise au jeu, explorer cette part sombre m’interroge, m’amuse. Un de mes personnages préférés reste La Nature morte aux bijoux qui évolue beaucoup au fil des pages pour s’adapter à la galerie.
Par contre, j’espère aussi ajouter des petites touches de lumière et de poésie – à travers des personnages comme Mamie Louise et aussi grâce à l’humour !
Les œuvres se commentent elles-mêmes et font leur propre restauration y a-t-il une volonté de montrer qu’il y a quelque chose que l’humain ne peut comprendre ou contrôler dans l’art ?
Je crois qu’une fois que l’œuvre – peinture ou sculpture – a quitté l’atelier, elle n’appartient plus à l’artiste. Pas plus aux galeristes, aux visiteurs, aux collectionneurs etc. Chacun a sa propre relation, sa propre visions. Mais, l’œuvre existe au-delà de ces regards. Elle a une vie propre qu’on essaye d’appréhender sans jamais vraiment y arriver.
Il y a-t-il une volonté pédagogique derrière ce livre ? Souhaitez-vous apprendre aux lecteurs – de manière ludique – comment fonctionne une galerie d’art ?
Au départ, non. J’ai écrit sur ce que je connaissais. C’était simple. Ça ne demandait aucune recherche. Je me suis aussi rendu compte que c’était une matière incroyable en termes de fiction.
C’est après la publication du premier tome que j’ai pris conscience de la dimension pédagogique. C’est souvent ressorti dans les commentaires des lecteur·ices qui appréciaient la découverte des coulisses de ces lieux d’exposition. J’ai donc inséré un glossaire à la fin du deuxième recueil. Je le vois plus comme un outil pédagogique qu’un outil de compréhension.
Les noms des œuvres sont en italique, comme sur tout bon cartel où tout bon catalogue d’exposition qui se respecte. Cela a pour effet de déstabiliser le lecteur mais aussi de brouiller la frontière des genres : essai d’art ou nouvelles fantastiques ?
Mon intention avec ces italiques, c’était plutôt d’apporter de la clarté ! Je voulais que les lecteur•ices puissent comprendre si un personnage était une œuvre ou non dès le premier regard. Cet univers où les sculptures et les peintures prennent vie peut-être un peu perturbant au premier abord. C’était un moyen d’apporter une boussole.
Par contre, le fait que ce soit aussi un clin d’œil par rapport au cartel et au catalogue ne me dérange pas du tout !
Les nouvelles mélangent les genres du policier et de l’humour, mais sont aussi présentées comme des scénarios télévisuels. Par exemple, on peut lire dans les nouvelles des tournures de phrases telles que : « Le Tripot, nuit 1 » qui est loin d’une narration littéraire. Pourquoi ce mélange ?
Encore une fois, c’est un souci de clarté.
J’ai bien conscience que l’univers déroute (des œuvres qui bougent etc.).J’essaye d’être la plus précise possible avec des incises indiquant le lieu et le moment. Ça a vraiment été un de mes soucis et enjeux en écrivant ce recueil : être claire. Ne pas faire flotter de mystère plus que nécessaire, ce qui est un de mes défauts en tant qu’écrivaine. Un peu, c’est bien, mais il ne faut pas en user.
Par ailleurs, ces variations dans la narration est-elle une volonté de déstabiliser le lecteur ? Vous alternez les lettres des personnages à l’autrice, le changement de narration (vous passez de la troisième à la première personne dans la même nouvelle)…
Je vois ce recueil comme un laboratoire dans lequel je fais différentes expériences en termes d’écriture. Par exemple, j’ai eu l’idée des formats lettre à force de lire des romans de Wilkie Collins (encore une référence à un romancier britannique) qui en insère beaucoup au fil de ses récits. Je trouvais intéressant d’utiliser cette forme, puisque les œuvres ne peuvent pas communiquer entre elles la journée, ni avec les non-œuvres.
Par contre, je n’étais pas sûre de les garder dans le recueil. Au moment de la sélection des textes, je les trouvais un peu à part. J’ai longuement réfléchi et j’ai fini par les insérer en me disant qu’elles avaient leur place et s’intégraient dans l’ensemble.
Est-ce que vous avez observé certains comportements que vous dénoncez-ici ? Comme le « trafic des gommettes rouges » par exemple. Il s’agit dans ce cas des œuvres d’art qui s’attribuent elles-mêmes des gommettes rouges qui sont un signe universel pour signifier qu’une œuvre est vendue, et qui prêtent donc de l’intérêt, de la valeur, à l’œuvre affublée de la gommette.
J’ai entendu des rumeurs – vraies ou fausses, difficile de vérifier – de marchands qui plaçaient quelques gommettes factices pour stimuler les collectionneurs au moment des vernissages. Un peu comme un restaurant qui paierait des acteurs pour créer de l’animation et amener des clients lors de l’ouverture.
Quand j’ai créé le personnage du Garçon au Bonnet, une œuvre roublarde qui ne recule devant aucune petite combine pour s’enrichir, ou tenter de le faire, j’y ai repensé. Je me suis dit que c’était tout à fait son genre de trafiquer des gommettes.
Des acheteurs qui n’achètent pas, des collectionneurs capricieux et fétichistes, des œuvres jamais vendues qui se moquent les unes des autres eut de leur laideur, des galeristes incompétents et désespérés de conclure une vente : est-ce que vous avez souhaitez mettre en scène une petite galerie pour critiquer le monde de l’art en général ?
On est proche du : qui aime bien, châtie bien. Les galeries, ce sont des lieux d’expositions formidables, dirigés par des gens passionnés. C’est une chance de pouvoir les visiter gratuitement.
Ce qui ne m’empêche pas de me moquer de leurs travers. J’ai eu la chance de pouvoir les observer de près et j’ai un petit penchant pour le sarcasme et l’ironie.
Sur le Bar aux Lettres, j’ai déjà incité les lecteurs à pousser la porte des galeries d’art. Pour vous, d’où vient l’appréhension qu’elles provoquent et que conseillerez-vous pour oser y entrer ?
C’est un sujet auquel je réfléchis beaucoup ! Je vais essayer d’être synthétique… Je pense qu’il y a plusieurs facteurs. Tout d’abord, la peur de ne pas être à sa place : ne pas maitriser les codes de l’art contemporain, de ne pas être un collectionneur etc. Les galeries véhiculent une image élitiste. Cela ne joue pas en faveur de la démocratisation de leur entrée.
Ensuite, une raison plus pragmatique : une grande partie des potentiel·les visiteur·ses ne sait pas que l’entrée est gratuite. Il y a donc le frein d’une supposée billetterie et au final un manque d’information. Dans le même ordre d’idées, les galeries sont réparties de manière très inégale sur le territoire. Près de la moitié sont situées à Paris. Ensuite, elles se trouvent majoritairement dans de grandes métropoles ou des villes touristiques (Saint-Paul-de-Vence, Honfleur). Elles sont donc difficilement accessibles pour certains publics.
Quant à mes conseils… Je dirais repérer des artistes qu’on aime (sur Instagram, dans des magazines), se renseigner pour voir s’ils exposent en galerie. Si c’est le cas, repérer une date d’expos, un vernissage et se lancer ! Il y a d’ailleurs de grandes chances pour que les autres choix du galeriste correspondent à votre sensibilité…
Une autre possibilité, les événements type « Paris Gallery Weekend ». De nombreuses galeries sont ouvertes en simultanée et accueillent un large public. C’est plus facile de pousser leurs portes dans ses conditions !
Quel a été votre parcours ?
Je fais partie de cette catégorie d’autrice qui a toujours écrit. J’ai des souvenirs de petits textes, de manuscrits qui remontent à mon enfance et à mon adolescence. Je suis aussi une lectrice passionnée depuis toujours. Mon écriture est très liée à la lecture.
Après, au-delà de cette envie et de ces essais, j’ai mis des années à comprendre que l’inspiration ne viendrait pas taper à ma fenêtre un soir et que je ne pondrais pas un chef d’œuvre en une semaine, abreuvée de café. Il fallait travailler.
J’ai tâtonné. Après mes études, je me suis lancée dans un roman victorien avec des thématiques que j’affectionne : l’art, la folie… Avec du recul, je me suis perdue dans les recherches et je n’ai pas dépassé le premier jet.
J’ai alors décidé de travailler des textes plus courts pour affiner ma plume, trouver le rythme, construire une structure. C’était mon laboratoire d’écriture. De fil en aiguille j’avais de quoi remplir un recueil, puis un deuxième !
Quelles ont été vos études, Lettres Modernes et Histoire de l’art ?
J’ai fait une hypokhâgne en lettres et sciences sociales, avant d’intégrer Sciences Po Lille. En master, je me suis spécialisée en Management des Institutions Culturelles. C’est d’ailleurs en cherchant un stage obligatoire pour ce master que j’ai poussé la porte d’une galerie pour la première fois. C’était un lieu superbe : une maison de maitre lilloise dans un jardin luxuriant… J’ai aussi été frappé par la personnalité de la galeriste et sa passion pour défendre ses artistes. Je me suis dit, et je le pense toujours, qu’y travailler est une manière de côtoyer la création contemporaine de très près. C’est une grande chance.
Êtes-vous collectionneuses vous-mêmes ? Êtes-vous artiste ?
Je suis une collectionneuse modeste pour l’instant. J’ai quelques photos, des gravures. Mais oui, c’est important de soutenir les artistes que j’aime et c’est un moyen de le faire, quand c’est accessible.
En parallèle de l’écriture, je dessine aussi. La couverture du recueil est réalisée à partir d’un de mes collages. Ce sont des pratiques qui me procurent beaucoup de joie et j’essaye de me trouver des temps pour m’y consacrer, en écoutant un bon podcast de préférence.
Avez-vous acheté L’homme à l’oiseau ou prévoyez-vous de le faire ?
L’Homme à l’oiseau a trouvé un nouveau domicile chez un couple de collectionneurs. J’ai eu un pincement au cœur quand j’ai appris sa vente. Je l’aurais bien vu chez moi ! Il aurait été aux premières loges pour veiller sur les recueils…
Appliquez-vous les conseils d’écritures que vous distiller dans le livre, comme celui qui consiste à écrire tous les jours par exemple ?
J’allais répondre spontanément que oui. En réfléchissant, je me rends compte que ce n’est pas forcément le cas. Je m’explique. C’est la photographie de mes conseils d’écriture au moment où j’ai écrit les nouvelles.
Ces derniers évoluent, en fonction de mes découvertes et de mes nouvelles habitudes.
J’ai longtemps pensé que c’était un peu présomptueux, ou un manque d’imagination, le fait d’écrire sur l’écriture en tant que pratique. Je me rends compte que c’est un sujet de préoccupations parmi tant d’autres et que je peux en parler, sans avoir peur d’ennuyer mes lecteur•ices. Je l’espère, en tout cas.
Par contre, concernant l’exemple choisi dans la question (écrire tous les jours), je l’applique encore.
Vous-mêmes intervenez dans le récit en tant que personnage et autrice. Est-ce un clin d’œil aux Dialogues de Jean-Jacques Rousseau (Rousseau juge de Jean-Jacques) ? Les échanges entre les personnages et l’autrice y font échos car il y a la même dynamique entre représentant et les détracteurs du travail de l’auteurice.
Je n’aurais jamais pensé à citer les Dialogues… Ce n’est donc pas intentionnel. Après, c’est une œuvre que j’ai étudiée, donc l’inconscient s’est peut-être chargé de faire le reste. Qui sait ! C’est en tout cas, c’est une une dynamique que j’aime beaucoup. Elle me permet d’évoquer mes réflexions, mais de garder un certain rythme, qui est essentiel si je ne veux pas perdre mes lecteur•ices au fil de mes pages !
Quels sont prochains projets littéraires et artistiques ?
Je viens de finir le tome 3 des Enquêtes de L’Homme à l’oiseau : Le Grand Tour. Ce sera un roman cette fois ci. Il met encore en scène L’Homme à l’oiseau, qui trouve son Watson en la personne de Louise, une visiteuse octagénaire fantasque, qui fait déjà une apparition dans les recueils. Ils doivent coopérer pour retrouver une oeuvre qui a disparu de la galerie.
En parallèle des dernières retouches sur ce manuscrit, je me lance dans le premier jet du tome 4 qui signe le retour de La Nature morte aux bijoux et sa clinique pour œuvres d’art moches.
Ces deux projets – à des stades d’avancée très différents – devraient bien m’occuper ces prochains mois !
Merci infiniment de m’avoir accordé votre temps et de nous avoir livré ces belles réponses, en incursion dans le monde des galeries d’art.
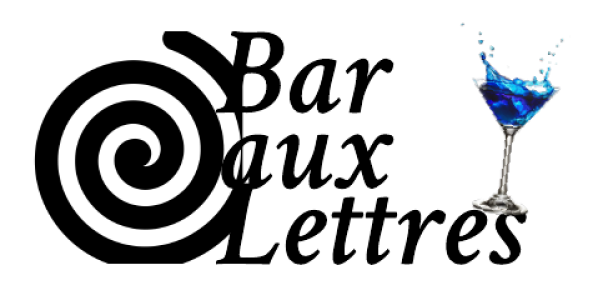



Un commentaire Ajouter un commentaire