Partir, c’est mourir un peu, d’Alexandre Page est réellement un chef d’œuvre. Il va être difficile pour moi de le résumer pour laisser place à l’auteur sans trop en dire.
Alexandre Page, Partir, c’est mourir un peu, auto-édition, 2019, 775 pages.

Durant ces pages, on vit avec la dernière famille impériale de Russie, les célèbres Romanov. Le roman est émouvant, extrêmement bien écrit, on s’attache profondément à la famille et cela a quelque chose d’horrible, tout au long de la lecture, car on connait leur fin. Ou du moins, on en a une vague idée.
On se surprend à être fascinés par ces personnages : le Tsar, l’impératrice, leurs quatre filles et le tsarévitch. Loin d’être dépeints comme des Marie-Antoinette ou des tortionnaires, on découvre un souverain tourné vers l’Occident et profondément bon. On adore cette famille pas bling-bling, bien que disposant d’une grande liberté par ses moyens, mais investie de modestie, qui aime les choses simples de la vie : les jeux enfantins et la famille. Ce cœur enfantin et pur leur portera bien des déboires en politique et commérages.
La lecture de ce roman est également l’occasion d’une belle bibliographie de divers mémoires de personnes ayant entourés les Romanov.
Bonjour Alexandre, merci de m’avoir proposé cette fabuleuse lecture et merci de m’accorder un peu de votre temps pour répondre à mes questions.
– Pour commencer, pourriez-vous raconter votre parcours ?
Bonjour ! Eh bien Alexandre Page, je suis historien de l’art (docteur mais pas médecin !), et depuis un peu moins d’un an écrivain de fiction (je précise car je publie de la non-fiction depuis plus longtemps). J’ai toujours apprécié l’écriture de fiction, mais je l’avais un peu mise de côté du fait de mon mémoire puis de ma thèse, et après ma soutenance (2017) j’ai plongé directement dans le monde de l’écriture et de l’édition en obtenant un poste de commissaire scientifique d’une exposition. J’étais notamment chargé de la rédaction du catalogue publié chez Faton. C’était ma première grosse publication et ça m’a redonné envie d’écrire de la fiction mais cette fois avec l’ambition de la publier, ce que je n’avais jamais fait. J’ai d’abord écrit un polar historique (que je garde de côté pour l’instant) et donc Partir, c’est mourir un peu ensuite que j’ai publié en juillet 2019.
– Quelle est l’exposition sur laquelle vous aviez travaillé ?
Il s’agissait de l’exposition Marcellin Desboutin au musée Anne-de-Beaujeu à Moulins. C’était la première rétrospective sur l’artiste depuis sa mort. Une expérience très sympa ! Il y avait des discussions pour que je participe à une autre dernièrement, mais le coronavirus a pas mal bouleversé les calendriers !
– Partir, c’est mourir un peu se joue du « pacte de lecture », vous brouillez brillamment les pistes entre le roman et l’autobiographie, pourquoi ce choix ?
Pour moi l’idée c’était de faire un roman historique à la fois très documenté et en même temps pas lourd et indigeste à lire. Un ouvrage qui trouverait le juste compromis entre le savoir et le romanesque. C’est pour cela que j’ai de suite banni la 3e personne du singulier côté narration et qu’il me fallait un protagoniste dans l’intrigue. Bien sûr il me fallait un protagoniste survivant pour avoir une certaine omniscience (notamment sur les faits qu’il n’a pas vécu lui-même), mais qui n’ait pas déjà écrit ses mémoires. Je suis tombé lors de mes recherches sur un document qui mentionnait un certain Kleinenberg, précepteur d’allemand des grandes-duchesses. Ce personnage était allemand et est reparti en Allemagne en 1914 mais il était parfait pour moi. J’ai gardé son nom, je lui ai créé une vie nouvelle, et je l’ai utilisé comme protagoniste « témoin » de l’histoire.
L’avantage de l’autobiographie (plutôt des mémoires car finalement le livre se concentre plus sur les figures historiques que le narrateur a connues) c’est que ça permet une narration plus souple que le roman. On passe plus naturellement d’un lieu à l’autre, d’un événement à l’autre, et les digressions par exemple sont moins ressenties comme pénalisant l’intrigue car d’intrigue il n’y en a pas vraiment à proprement parler.
– Votre roman peut-il être vu comme un assemblage, une adaptation, de témoignages et de mémoires ?
Oui, c’est un roman patchwork, et je l’ai construit ainsi. J’ai procédé comme pour ma thèse. J’ai commencé la rédaction du premier jet à partir des faits racontés dans une dizaine de mémoires, souvenirs et autobiographies des protagonistes vrais de l’histoire, puis ensuite j’ai ajouté les éléments nouveaux découverts dans chaque ouvrage lu en plus. Ca m’a permis de reconstituer des scènes avec beaucoup de détails car elles sont parfois vues à travers quatre ou cinq personnages différents (mais on a le sentiment de les voir seulement à travers ceux du narrateur). J’ai aussi utilisé des ouvrages d’époque pour contextualiser mieux les lieux, les costumes, lorsque les sources primaires n’étaient pas très bavardes. Par contre je n’ai pas utilisé d’ouvrages d’historiens contemporains car je voulais que mon personnage parle vraiment des faits comme un homme en aurait parlé en 1948 (date de parution fictive de l’ouvrage).
– Pourquoi avoir choisi de créer le personnage d’Igor Kleinenberg, ce personnage en particulier, originaire d’Estonie et professeur d’allemand des filles du tsar ?
Eh bien pour le nom et l’origine je l’ai déjà exposé. Pour le reste, il me fallait un personnage qui ne soit pas trop russe (il y a une explication dans la fin de mon roman mais je n’en dirai pas trop pour pas divulgacher), ce qui allait parfaitement avec Kleinenberg, et qui le soit quand même assez (un Allemand n’aurait pas pu rester en Russie après 1914). Par ailleurs attacher mon narrateur au tsésarévitch Alexeï n’était pas envisageable du fait de sa jeunesse (il aurait fallu que mon héros entre en scène en pleine guerre), aussi je l’ai rattaché aux grandes-duchesses pour cette raison.
Enfin toute l’écriture relative à sa famille maternelle m’était nécessaire pour lui offrir une porte de sortie après la révolution.
– Combien de temps ce projet a-t-il pris pour voir le jour ? Quelles ont été vos techniques d’écriture et, surtout, de recherches pour mener à bien ce projet ?
En tout 1 an et demi (décembre 2017 – mars 2019), mais évidemment avec un bagage antérieur car le sujet m’intéressait depuis longtemps. Pour l’écriture j’en ai déjà parlé un peu, pour les recherches je suis parti de ce que je savais déjà, puis j’ai dénoué les fils (lorsqu’un personnage était cité dans une source, j’allais voir sur le net s’il avait lui-même écrit qque chose). J’ai utilisé les mêmes techniques qu’en thèse pour le reste en exploitant les bases en ligne (Gallica, Archive.org) et des sources numérisées russes qui sont pléthoriques en ligne sur les Romanov (il y a des sites spécialisés qui mettent gratuitement à disposition des livres introuvables, même au format papier). Je me suis aussi appuyé sur la riche documentation iconographique pour les lieux, les costumes, mais aussi les gestes, les habitudes des protagonistes qui en disent long. Par ailleurs il existe quelques films anciens montrant les Romanov dans leur vie publique ou privée, ce qui est idéal là-encore pour cerner les personnages et les ambiances.
– Quelles ont été vos motivations pour vous attaquer à un projet d’une telle ampleur ?
Le sujet m’intéresse depuis très longtemps (la Russie en général), et j’étais très étonné des faiblesses littéraires en français (et en anglais et en russe aussi) sur une histoire et des personnages aussi passionnants. Soit les romans sont trop « fictifs », et inventent énormément, ce qui est bête alors que la réalité se suffit à elle-même ici, soit on verse dans une non-fiction assez aride elle-même très tournée vers le « mythe Anastasia ». Mon intérêt personnel et l’idée qu’il y avait vraiment une pierre originale à écrire sur le sujet m’ont déterminés à mener le projet à bien, d’autant que j’étais dans la rédaction en pleine commémoration des Romanov (2018). Ca m’a motivé davantage !
– Souhaitiez-vous rétablir la réalité dans l’imaginaire populaire français ? Comme par exemple, les difficultés d’armement de la Russie lors de la Première Guerre Mondiale, alors que dans notre imaginaire collectif, les Russes étaient des sauveurs qui avaient l’avantage. Ou encore, aviez-vous pour volonté de réhabiliter la vérité sur Raspoutine, considéré par la plupart des Français comme un être infâme (la culture pop aidant à nouveau par le biais, par exemple, du dessin animé Anastasia) ?
Clairement j’ai pris le parti de m’éloigner des fables « marketing », notamment le mythe Anastasia ou la vision pop de Raspoutine. Je voulais vraiment être au plus près de la réalité telle que décrite par les protagonistes. Pour la 1ère guerre, oui, disons que c’est un front très mal connu à l’Ouest, alors il était important pour moi de le développer aussi et de le présenter dans toutes ses ambiguïtés. De manière générale c’est ce qui a nourri ma volonté d’exhaustivité dans mon roman. Concentrer autant que possible la matière authentique sur les Romanov pour dire les choses telles qu’elles étaient et esquiver les théories ou les falsifications.
– Une vraie tendresse se dégage de votre écrit, et même un réel engagement sentimental et politique envers le tsar. Quelles techniques avez-vous utilisé pour créer une intimité si forte, gommant la fiction, entre la feue famille impériale et le lecteur ?
Comment avez-vous articulé les confidences ou les dialogues entre le tsar et le narrateur ? Puisque ces passages relèvent de la fiction ? Comment avez-vous construit la parole du tsar ?
Oui, je pars du principe que lorsqu’on écrit sur un personnage qui a vécu il faut être bienveillant, sinon pourquoi écrire sur un personnage qu’on apprécie pas ? Bienveillant et vrai aussi. Je ne voulais pas recréer des personnages en carton-pâte à des années lumières de ce qu’étaient les vrais protagonistes, surtout avec la matière à disposition pour être vrai. Comme j’ai surtout utilisé des documents intimes (lettres, journaux privés) et des mémoires de gens qui ont vraiment connu le tsar et la famille impériale, ça m’a clairement permis de saisir beaucoup mieux les sentiments, les émotions que si j’avais travaillé à partir d’ouvrages historiques. Pour les dialogues c’était pas facile. Evidemment il y en a peu dans des mémoires par définition, mais le peu a été le plus dur à écrire. Je me suis appuyé sur des phrases réellement écrites par les protagonistes d’abord ou rapportées par des témoins, et lorsque j’ai dû inventer j’ai essayé de saisir la manière d’écrire des personnages dans leurs lettres. Par exemple a un moment donné la grande-duchesse Tatiana dit une phrase au narrateur à propos d’un portrait satirique offert à sa sœur par des marins du yacht impérial. Cette phrase apparaît presque mot pour mot dans une lettre de la grande-duchesse à un proche.
– Est-il vrai que « Partir, c’est mourir un peu », phrase d’Edmond Haraucourt qui prête son nom à votre roman, a été prononcée par l’impératrice au départ de sa demeure ? Pourquoi avoir choisi cette déclaration en particulier ?
La phrase n’a pas été prononcée par l’impératrice à ce moment-là, mais elle l’a écrite dans une lettre à son époux qui était sur le front peu avant la révolution. Evidemment je ne pouvais pas plonger mon héros dans l’intimité des lettres de l’impératrice, donc j’ai utilisé ce subterfuge pour lui donner malgré tout une place dans mon récit. C’est de là qu’est venue l’idée du titre qui pour moi collait parfaitement à mon roman.
– Lors de la guerre et de la chute du tsar, le livre se transforme presque en journal militaire au jour le jour, et avant cela, il documentait déjà les chaises musicales politiques et leurs manigances. En quoi était-ce important pour vous de créer, malgré les considérations diplomatiques, un roman ? De plus, quelles techniques avez-vous utilisées pour que ce dernier ne se transforme pas en lourd livre d’histoire ?
Je crois que le contexte était quasiment un roman à l’état brut tant il y a des choses vraiment incroyables qui surviennent en Russie à cette époque (il y a au moins dix synopsis de romans d’espionnage contenus dans mon roman !). La difficulté était plus de rendre la matière digeste en effet. Pour ma part j’ai essayé d’alterner entre ce qui relève de l’expérience concrète du narrateur (qui reste au palais pendant la guerre et vit la situation à l’arrière, les hôpitaux…) et de l’histoire narrée plus classiquement. L’aspect immersif du vécu allège considérablement l’aspect purement historique. Un documentaire animalier avec une voix off est plus lourd qu’avec un personnage qui arpente la savane ou la jungle en faisant ses commentaires. Je me suis inspiré de ce principe pour donner plus de vitalité au roman. J’ai essayé de toujours introduire les anecdotes à travers une discussion à priori anodine, un souvenir amusant ou moins amusant, bref, de recourir à tous les procédés qui donnent une animation à l’histoire.
– Comme un reporter dans le feu de l’action, vous documentez également les horreurs de la révolution, l’escalade de la violence (sans parler du meurtre des Romanov). Votre livre comporte-t-il une certaine mise en garde contre la répétition de l’histoire (notamment avec la course à l’armement, dans laquelle les pays riches offrent les armes à n’importe quel camp pourvu qu’il lui prête allégeance), et contre les extrémismes ?
Eh bien pas directement, mais c’est vrai que la situation de l’époque résonne étonnamment avec nombre de réalités actuelles. Il y a des points communs vraiment frappants, notamment sur le danger des infox, qui étaient légions au début du XXe siècle exactement comme aujourd’hui, alors qu’on semble les découvrir ! Pour ma part il y a peu d’événements que je n’ai pas réussi à associer à des événements actuels, à des situations présentes, ce qui montre bien que l’histoire est un éternel recommencement pour le pire et le meilleur.
– Pourquoi avoir choisi l’autoédition ?
Ce n’était pas vraiment mon premier choix car je la connaissais assez mal (pour moi ça se résumait à des livres papiers à imprimer soi-même et à écouler ou à du numérique). J’ai donc envoyé mon roman à qques maisons d’édition (Plon, Presses de la Cité, Belfond, L’Archipel, Denoël) pour tester les retours, en prévoyant de nouveaux envois en deuxième vague vers d’autres maisons. J’ai eu 2 retours négatifs et 3 réponses jamais parvenues. Entretemps je m’étais renseigné sur l’autoédition et j’ai découvert les grosses possibilités qui existaient. Plutôt qu’une deuxième vague d’envois j’ai donc choisi l’autoédition en me disant que de toute façon jamais un éditeur prendrait un premier roman de 775 p. avec illustrations, et que je n’étais pas prêt à faire des coupes drastiques dans mon texte pour le rendre plus « commercialisable ».
– Vous proposez également de nombreuses photographies d’archives, en quoi était-ce important pour vous de faire figurer ces documents ?
L’idée était de donner un visage aux protagonistes, ce qui n’est pas toujours possible dans la littérature mais qui m’était permis ici. Par ailleurs les Romanov étaient des férus de photographies, et puisque la Beinecker Library met librement à disposition l’intégralité des albums qu’elle conserve de la famille impériale, je me suis dis qu’il était dommage de ne pas utiliser cette manne documentaire.

– Par ailleurs, vous êtes très actif sur twitter où vous continuez à faire vivre votre roman. Quelle est votre démarche concernant ce réseau social ?
Pour ma part j’utilise les réseaux sociaux principalement comme une extension de l’univers de mes livres (comme les bonus d’un DVD), et puisque ces derniers s’appuient sur l’histoire, ça me permet aussi de jouer mon rôle d’historien. Les lecteurs peuvent ainsi en découvrir plus, ceux qui ne l’ont pas lu peuvent aussi être tenté de le faire (je pense qu’en matière de roman historique il est bon aussi qu’un éventuel lecteur puisse avoir une certaine confiance dans le sérieux de l’auteur).
Après n’ayant pas de blog (trop compliqué à tenir), je préfère les réseaux sociaux et j’essaye donc d’être actif aussi régulièrement que possible pour compenser (sur twitter et instagram).
– Vous êtes docteur en Histoire de l’art, quel sujet étudiez-vous ?
J’ai soutenu ma thèse en 2017 (déjà !). Ma spécialité est l’estampe de la seconde moitié du XIXe siècle, c’est-à-dire les arts de la gravure imprimée, de l’illustration de livres, de l’affiche… Mes recherches portent aussi sur la peinture à la même période, mais c’est mon domaine de compétences élargi. Ma focale c’est vraiment l’estampe qui était au cœur de mon sujet de thèse.
– Pour finir, quels sont vos prochains projets ? Sur quoi travaillez-vous actuellement ?
Eh bien en ce moment je suis dans la finalisation de mon prochain roman, qui tout en s’inspirant encore de l’histoire (j’ai eu l’idée du sujet lors de mes recherches pour Partir, c’est mourir un peu) prendra beaucoup plus de liberté et s’apparentra, du moins est-ce mon objectif, à un mélange inspiré des romans d’aventure à l’ancienne comme ceux de Jules Verne ou de Ryder Haggard et d’Indiana Jones (qui s’inspirait déjà de ces modèles). Ce sera plus un roman d’aventure se déroulant à la fin du XIXe siècle qu’un roman historique pur et dur.
A nouveau, je ne peux que conseiller ce merveilleux ouvrage, qui, en plus d’être hautement instructif, est bouleversant. Merci encore, Alexandre Page, de m’avoir accordé votre temps ainsi que cette belle et dense lecture.
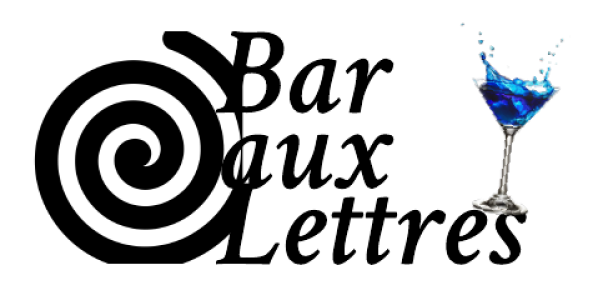
A reblogué ceci sur Le Bien-Etre au bout des Doigts.
Je voyais passer les tweets de l’auteur (qui m’intriguaient), et me voici éclairée et attirée par ce roman 🙂 merci !
Aaaah ! Je suis ravie que cet interview ait pu t’éclairer ! 🙂
Maintenant (comme tu l’as compris je pense) je ne peux que te conseiller de te ruer sur cette formidable lecture ! Je l’ai immensément adorée. Les pages filent et on a un certains vertiges en se rendant compte de tout le travail que cela a dû lui demander. Vraiment, malgré une géopolitique complexe dans certains passages, Alexandre Page a su les rendre intéressants (les passages) tout en gardant une grande tendresse, et laissant le lecteur s’attacher à cette famille.
Bref, je serai ravie d’avoir ton avis quand tu l’auras lu !
Je note le titre en tout cas, surtout que la Russie a une histoire passionnante que j’ai (un peu étudié) ayant fait du russe au lycée 🙂
Oui ! Comme l’auteur le dit, cette histoire se passe sur peu de temps mais c’est déjà si riche ! C’est vrai que l’histoire de la Russie est passionnante
Bravo pour la thèse et le livre… Et merci à toi pour cette très intéressante prestation…
Avec plaisir, je pense que le livre te plairait beaucoup, j’ai adoré personnellement. À la lecture, on se rend vraiment compte de tout le travail c’est très impressionnant.
Très belle interview approfondie, sensible et ouverte à la réflexion. Merci pour ce partage, et je reviendrai régulièrement en ce blog. Eric (blog Débredinages).
Bonjour, merci pour votre passage sur le blog ! L’interview méritait d’être approfondie, on se rend, en effet, compte au fil des pages du travail fourni par l’auteur et je souhaitais vraiment mettre en valeurs ses recherches. Bien qu’il y ait une grande sensibilité et beaucoup de qualités dans son écriture.
Je suis ravie de savoir que vous reviendrez, je vous dis à bientôt.
Effectivement, wouhaou, ça donne envie!
Je ne peux que conseiller ce livre ! On se rend bien compte des recherches vertigineuses qui ont dû être menées mais c’est aussi un bon roman qui renferme beaucoup d’émotions !
Déjà le titre m’intriguait ou m’attirait beaucoup mais j’ai trouvé passionnant de lire le processus d’écriture. Comme quoi avoir fait une thèse peut donner un véritable avantage méthodologique pour écrire un roman, notamment historique.Merci pour ce riche partage ! 🙂
Merci à toi de passer sur le Bar aux Lettres !
Je ne suis pas sûre que la thèse soit une obligation, mais avoir une méthodo en acier, sans doute ! En tout cas, à la lecture, on se rend compte des efforts fournis et ça n’en est que plus impressionnant !